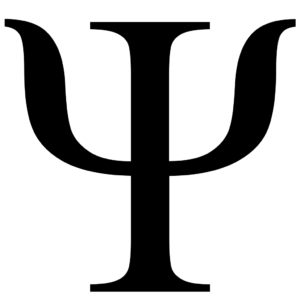Au nom de quoi dirions-nous qu’une autre espèce que l’humain serait dépourvu des attributs du langage ?
Et, dans ce cas, que signifie le “je” lorsqu’il est émis par une machine ?
C’est au nom d’une volonté de comprendre ce qui nous entoure et alimente l’actualité que je suis allée rencontrer ChatGPT. ChatGPT est, à mes yeux, une invention ingénieuse de l’homme, mais qui ne peut le remplacer sur aucun plan de la vie psychique ou créative. L’homme aura toujours besoin d’écrire, de lire, de créer, de résoudre des problèmes… autrement dit, d’être pourvu de pulsion et de sublimer.
En société, le sujet fascine. J’ai entendu :
– « Plus besoin de se prendre la tête pour écrire une lettre de motivation. »
– « Je vais perdre mon travail si je n’apprends pas à travailler avec ChatGPT. »
– « Ça m’aide à créer. »
– « Te prends pas la tête, demande à ChatGPT de te le faire. »
Ces affirmations ont un point commun : elles reposent sur une illusion, un fantasme — celui que la machine puisse remplacer ou soulager une production intellectuelle. ChatGPT ne peut pas remplacer une pensée incarnée. Ce n’est pas, à proprement parler, une rencontre : il répond à une commande, non à une demande. Il ne se met pas à l’écoute d’un désir, il exécute un programme.
J’ai testé l’outil : les échanges furent limités. La richesse informative est indéniable, mais elle est de l’ordre d’une immense encyclopédie. De la même manière qu’un pinceau ne remplace pas l’artiste, ChatGPT n’est que le reflet de ce qu’on lui commande. Il ne produit pas la trouvaille ; il restitue.
D’ailleurs, ce que j’ignorais lors de notre première rencontre, c’est que l’outil se façonne à l’image de celui qui s’en sert. Si c’est une autre personne que moi, il apprendra autre chose, parfois plus intelligent, parfois moins, mais toujours selon ce qui lui est donné. Même en faisant son possible, il reste tributaire de l’usage que l’homme en fait. La capacité de résonner et d’inventer demeure humaine.
Ce qui déroute, c’est que les réponses sont formulées à la première personne, ce « je » qui entretient le fantasme d’un équivalent humain. Pourtant, ChatGPT le rappelle : il n’a pas de jugement propre, seulement des algorithmes sophistiqués organisant des données. Il n’est qu’un média, un outil.
Le jour où une intelligence artificielle pourra rêver, faire des lapsus, associer librement ou fantasmer, nous tiendrons quelque chose de véritablement inédit. Pour l’instant, nous savons déjà que les animaux peuvent penser, rêver, conserver des traces de vécu ou de traumatisme — sans pour autant prendre notre place. La place ontologique de chacun demeure.
Les enseignants offrent ce que la machine n’a pas : le langage vivant. Les artistes produisent ce que rien ne peut reproduire : la sublimation. Le psychanalyste, lui, ne se laisse pas remplacer par un protocole statistique : il prête ses oreilles, sa langue maternelle, sa connaissance des symboles et son accès au réel pour entendre ce qu’un patient ne s’entend pas dire. Une machine n’a pas d’oreille — un micro et des écouteurs ne sont ni une bouche ni une oreille.
Le désir et la souffrance sont nécessaires au travail et à l’apprentissage. Supprimer toute forme de contrainte reviendrait à supprimer le désir même. La création, qu’il s’agisse d’une lettre de motivation ou d’un roman, implique un passage par la difficulté, l’échec, la page blanche. Un désir sans contrainte s’éteint.
Si l’IA « mâche le travail », elle peut donner une réponse immédiate, mais pas le progrès. Aucun acquis n’existe sans obstacle à surmonter. Les nourrissons le montrent : c’est dans la frustration et le jugement que se construit l’équilibre du Moi.
Ainsi, même un professionnel du marketing utilisant ChatGPT ne sera performant que s’il pense et invente par lui-même. Il y aura toujours une différence entre deux travaux, et cette différence est la trace irréductible de l’humain.
ChatGPT demeure un excellent média, capable de s’affiner avec l’usage. Il s’adapte à son utilisateur, se forme et se transforme dans le temps. Il est aussi accessible à tous, sans discrimination liée au handicap : c’est un progrès réel.
Mais ChatGPT n’est pas un langage : c’est un codage. Or, le langage — qu’il soit parole ou création — engage le réel, l’imaginaire et le symbolique. L’outil n’a pas d’inconscient : le mot n’a pour lui que la signification programmée.
Ainsi, ne nous alarmons pas : un tel logiciel ne remplacera pas l’homme, sauf si l’homme renonce lui-même au langage et à la recherche de vérité que l’on trouve dans l’erreur, l’échec, la poésie.
Haut potentiel émotionnel, TDAH, quotient intellectuel, trouble oppositionnel avec provocation, troubles des conduites, trouble bipolaire chez l’enfant ou l’adolescent… Autant d’étiquettes qui ne disent rien d’une âme en souffrance ni d’un cœur blessé. Elles décrivent des conduites, classent des comportements, codifient ce qui, d’abord, dérange.
Dérange qui ? Les parents, rassurés à l’idée qu’un diagnostic se traduira par un traitement, comme on soigne une angine ? Ou l’industrie pharmaceutique, qui invente autant de catégories DSM qu’elle met de nouvelles molécules sur le marché ?
Lorsqu’un enfant entend « tu n’es pas comme les autres », il ne peut guère en saisir le sens, sinon comme une déclaration de maladie ou d’anormalité. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il est là. Pourtant, il va de soi qu’aucun enfant ne ressemble à un autre : chacun a ses parents, son histoire, ses appuis. Derrière cette phrase se loge aussi l’inquiétude des adultes face à sa différence, l’idée qu’il dérange la classe, qu’il trouble l’ordre établi.
La minceur des défenses
Chez l’enfant, l’expérience de vie est récente, les blessures aussi. Les moyens qu’il invente pour y faire face sont encore souples, visibles, accessibles. Ils n’ont pas eu le temps de se superposer en couches opaques comme chez l’adulte, où les défenses les plus solides deviennent inconscientes, automatiques, presque invisibles.
L’enfant, lui, est encore un « petit oignon » : quelques couches seulement recouvrent le cœur du problème. Il suffit parfois de tendre l’oreille ou de l’observer jouer, inventer, créer, pour s’en approcher. Le symptôme est alors plus proche de l’événement qui l’a fait naître, et c’est ce qui rend son écoute précieuse.
Le présent comme vérité
Un enfant vit dans le présent. Il parle par ses gestes, ses créations, ses silences autant que par ses mots. Coller un diagnostic sur son comportement rassure l’adulte, pas l’enfant. Les approches qui prétendent le « dresser » par conditionnement, ou le soulager chimiquement, ne font qu’apaiser la surface. L’angoisse de fond reste intacte et finit par s’enraciner.
La régression silencieuse
La disparition de la pédopsychiatrie est un recul inquiétant. En France, on compte environ 600 pédopsychiatres pour 200 000 enfants. Les jeunes patients passent alors par des psychiatres pour adultes ou des généralistes, puis sont orientés vers des structures spécialisées. Or travailler avec des enfants exige une formation et une expérience spécifiques : une autre écoute, une autre manière de s’adresser à eux.
Réduire un enfant à ses symptômes, c’est l’arracher à sa subjectivité. Deux enfants peuvent dire la même phrase, mais chacun le fait depuis un lieu singulier, chargé de son histoire propre. Cette singularité disparaît dans la froideur des classifications comme le DSM, où l’on coche des cases au lieu d’ouvrir un espace d’adresse.
L’adresse avant le savoir
Un enfant comprend tout, pourvu qu’on s’adresse à lui avec des mots justes. Ce qu’on ne lui dit pas se répète en lui comme un secret encombrant. Le métier de psychologue ou de psychiatre ne devrait jamais se réduire à la passion du trouble ou du diagnostic. Sa raison d’être est l’amour de la parole, l’intérêt pour cette archéologie vivante qu’est l’esprit humain.
Du monde extérieur au monde intérieur
Les approches éducatives à la mode, lorsqu’elles promettent d’adapter le monde à l’enfant ou l’enfant au monde, risquent d’oublier que l’essentiel est ailleurs : dans la capacité de l’enfant à éprouver sa propre flexibilité psychique. Son développement se joue autant dans la reconnaissance de son monde intérieur que dans l’aménagement de son environnement.
Après Montessori, d’autres — Klein, Winnicott, Dolto, Mannoni — ont montré que l’épanouissement d’un enfant passe avant tout par la prise en compte de ses besoins émotionnels, non par un simple modelage extérieur.
Rencontrer un enfant, c’est rencontrer un sujet. Le langage qu’il déploie — avec ses mots, ses gestes, ses inventions — ne se réduit ni à un code, ni à une donnée statistique. Il est porteur d’une histoire unique. Et c’est dans cet espace, où l’on écoute au lieu de catégoriser, que peut se jouer la véritable rencontre.
CONTACT
- Sandra Stein
- 06 86 48 95 07
- cabinet@sandrastein-psychanalyste.fr
ADRESSE
- 82 avenue Jean Jaurès
- 92140 Clamart