Haut potentiel émotionnel, TDAH, quotient intellectuel, trouble oppositionnel avec provocation, troubles des conduites, trouble bipolaire chez l’enfant ou l’adolescent… Autant d’étiquettes qui ne disent rien d’une âme en souffrance ni d’un cœur blessé. Elles décrivent des conduites, classent des comportements, codifient ce qui, d’abord, dérange.
Dérange qui ? Les parents, rassurés à l’idée qu’un diagnostic se traduira par un traitement, comme on soigne une angine ? Ou l’industrie pharmaceutique, qui invente autant de catégories DSM qu’elle met de nouvelles molécules sur le marché ?
Lorsqu’un enfant entend « tu n’es pas comme les autres », il ne peut guère en saisir le sens, sinon comme une déclaration de maladie ou d’anormalité. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il est là. Pourtant, il va de soi qu’aucun enfant ne ressemble à un autre : chacun a ses parents, son histoire, ses appuis. Derrière cette phrase se loge aussi l’inquiétude des adultes face à sa différence, l’idée qu’il dérange la classe, qu’il trouble l’ordre établi.
La minceur des défenses
Chez l’enfant, l’expérience de vie est récente, les blessures aussi. Les moyens qu’il invente pour y faire face sont encore souples, visibles, accessibles. Ils n’ont pas eu le temps de se superposer en couches opaques comme chez l’adulte, où les défenses les plus solides deviennent inconscientes, automatiques, presque invisibles.
L’enfant, lui, est encore un « petit oignon » : quelques couches seulement recouvrent le cœur du problème. Il suffit parfois de tendre l’oreille ou de l’observer jouer, inventer, créer, pour s’en approcher. Le symptôme est alors plus proche de l’événement qui l’a fait naître, et c’est ce qui rend son écoute précieuse.
Le présent comme vérité
Un enfant vit dans le présent. Il parle par ses gestes, ses créations, ses silences autant que par ses mots. Coller un diagnostic sur son comportement rassure l’adulte, pas l’enfant. Les approches qui prétendent le « dresser » par conditionnement, ou le soulager chimiquement, ne font qu’apaiser la surface. L’angoisse de fond reste intacte et finit par s’enraciner.
La régression silencieuse
La disparition de la pédopsychiatrie est un recul inquiétant. En France, on compte environ 600 pédopsychiatres pour 200 000 enfants. Les jeunes patients passent alors par des psychiatres pour adultes ou des généralistes, puis sont orientés vers des structures spécialisées. Or travailler avec des enfants exige une formation et une expérience spécifiques : une autre écoute, une autre manière de s’adresser à eux.
Réduire un enfant à ses symptômes, c’est l’arracher à sa subjectivité. Deux enfants peuvent dire la même phrase, mais chacun le fait depuis un lieu singulier, chargé de son histoire propre. Cette singularité disparaît dans la froideur des classifications comme le DSM, où l’on coche des cases au lieu d’ouvrir un espace d’adresse.
L’adresse avant le savoir
Un enfant comprend tout, pourvu qu’on s’adresse à lui avec des mots justes. Ce qu’on ne lui dit pas se répète en lui comme un secret encombrant. Le métier de psychologue ou de psychiatre ne devrait jamais se réduire à la passion du trouble ou du diagnostic. Sa raison d’être est l’amour de la parole, l’intérêt pour cette archéologie vivante qu’est l’esprit humain.
Du monde extérieur au monde intérieur
Les approches éducatives à la mode, lorsqu’elles promettent d’adapter le monde à l’enfant ou l’enfant au monde, risquent d’oublier que l’essentiel est ailleurs : dans la capacité de l’enfant à éprouver sa propre flexibilité psychique. Son développement se joue autant dans la reconnaissance de son monde intérieur que dans l’aménagement de son environnement.
Après Montessori, d’autres — Klein, Winnicott, Dolto, Mannoni — ont montré que l’épanouissement d’un enfant passe avant tout par la prise en compte de ses besoins émotionnels, non par un simple modelage extérieur.
Rencontrer un enfant, c’est rencontrer un sujet. Le langage qu’il déploie — avec ses mots, ses gestes, ses inventions — ne se réduit ni à un code, ni à une donnée statistique. Il est porteur d’une histoire unique. Et c’est dans cet espace, où l’on écoute au lieu de catégoriser, que peut se jouer la véritable rencontre.
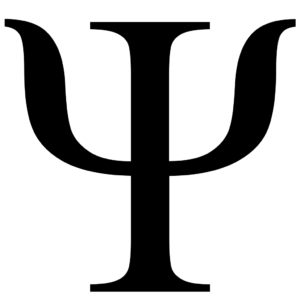
 SST
SST

Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!