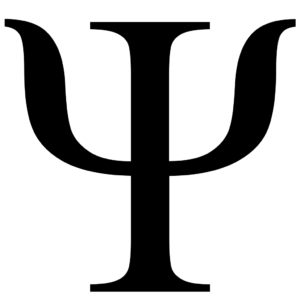Penser le soin, pour une médecine humaine et sociale
sous la direction de Philippe Cornet, préface de Gérard Ostermann
Paris, Editions In Press, 2023
Des chercheurs et universitaires des secteurs médicaux et sociaux débattent des enjeux du « tout scientifique » en médecine. Qu’est-ce que la Science ? Dans quelle mesure la médecine est-elle scientifique ?
Est interrogée la manière dont s’établissent les diagnostics (avec quels outils ?) et le traitement des symptômes dans la mesure lorsque la médecine, depuis quelques années, se fait fi du subjectif. Loin de diaboliser les progrès techniques, les auteurs se proposent d’étudier le sujet de la manière la plus complète possible : la parole est donnée aux scientifiques, aux philosophes, aux médecins, aux sociologues, anthropologues et littéraires.
Chacun y va de son expérience et de sa pensée pour rappeler ce à quoi engage les métiers de la médecine : un savoir de la science et un savoir du corps subjectif.
L’historique du lien entre science et médecine apparait clairement : la science devient une religion populaire si on l’envisage comme seule vérité incontestable. Les réflexions que présente cet ouvrage reposent justement sur l’objectivité et les résultats pointus que permettent les progrès techniques. Toutefois, les auteurs envisagent que l’utilité des sciences « dures » n’a de sens qu’en se souvenant que l’anatomie n’est pas dépourvue d’un sujet, que « le pilote de la machine » est celui qui cause (de) cette anatomie. Ainsi, c’est bien de la réalité observable inclus dans la singularité d’un patient dont il est question. L’objectif est de comprendre cette nécessité beaucoup oubliée.
Les auteurs passent tous par une question essentielle : de quoi parle cette négligence ? De l’homme face à ce qui lui apparaît comme insoutenable dans son existence : la souffrance, la maladie, le handicap, la vieillesse, la mort…
De quelle manière sont établis les recherches en médecine, et en quoi cela marque aussi les orientations théoriques des scientifiques ? Doit-on commencer par poser une question face à un objet, ou bien partir d’une réponse et en rechercher la démonstration adéquate ? Comment la recherche doit-elle s’entreprendre ?
En tant qu’admiratrice d’esprit des chercheurs et des curieux, je dirais que c’est incontestable : tout commence par une observation. Ou plutôt, que tout commence par la question que soulève une observation. Avancer en recherche c’est être incertain de ce que l’on va trouver, nous rappellent les auteurs. Découvrir et non recouvrir une recherche. Ce livre parle des commandes passées auprès des chercheurs dont le travail consiste le plus souvent à trouver la démonstration qui mène à un résultat déjà attendu, ou souhaité. Cela dit, ne nous leurrons pas, c’est toutes les recherches scientifiques qui sont concernées par ce système. L’aliénation nous touche quel que soit notre métier. Dans ce livre, on en discute et on fait du lien. On étudie et on observe.
On y discute aussi des conditions de travail des employés médicaux, qui face à toute sortes de manque de moyens, font des choix tel que celui de se reposer sur le tout biotechnologique pour gagner du temps tout en ayant le sentiment du devoir accompli. Finalement, c’est la coopération entre les chercheurs et les personnes de terrain qui donne la richesse et la complétude de cet ouvrage.
Il n’y a pas de médecine sans symptômes et il n’y a pas de symptôme qui pousse à consulter un médecin sans souffrance ou inquiétude. Comment traiter la souffrance sans le récit ? La souffrance est le cœur même de la subjectivité de chacun et c’est même elle qui donne le signal que quelque chose ne va pas dans le cœur et/ou dans le corps. On peut aller plus loin encore, en disant que sans le récit jamais l’homme aurait été amené à connaître les fonctions d’un organe et d’imaginer l’effet possible de cet organe sur une autre partie du corps.
Ce récit ne se mesure pas et pourtant il est une donnée empirique qui en dit long sur les traitements et les symptômes du corps. Comment traiter le corps sans théorie de la subjectivité ? Confondre la technologie et le soin, c’est s’assurer de l’absence d’une rencontre. Pourquoi ce renoncement à la rencontre qui pourtant est aux origines des plus grandes découvertes médicales ?
De cette manière, l’ouvrage se veut une proposition de solution pour les patients qui se sentent de plus en plus maltraités et pour les soignants qui souffrent aussi. Les auteurs proposent de revenir à une démarche épistémologique pour convaincre de l’utilité de la rencontre. Et c’est le bon moment, parce qu’aujourd’hui on « croit » en la médecine, on « croit » en nos soignants. La science n’est pourtant pas le seul mode d’accès au réel : le récit, la poésie, la musique en sont d’autres (pour ne citer qu’eux). « Ce ne sont pas les pinceaux ou les couleurs qui font Léonard de Vinci. Indépendamment du savoir, l’observation des faits est la première tâche du médecin. » souligne David le Breton (p. 58).
Aucun des auteurs ne nie la grande utilité des avancés des technologies biomédicales. La question n’est pas là. C’est bien la croyance en tout l’un ou tout l’autre dont il faut savoir se méfier.
Voilà ce qui est à entendre dans ce livre et qui est au cœur de ce travail pluridisciplinaire. S’il s’agissait de croire, alors on serait dans la foi, dans l’opinion et non dans le soin. En psychanalyse, on sait comme le réel et l’imaginaire du patient permettent d’accéder à sa souffrance, en tant que ce qu’elle est, à son savoir-faire et à ce qui fonctionne moins bien.
Un livre qui doit être lu, et relu de temps à autre afin de s’assurer de ne pas sortir de sa vocation de chercheur ou de médecin. Car les faits et revendications présentés par cet ouvrage peuvent s’appliquer à tous les domaines recherches, de savoir et d’études : philosophie, économie, histoire… Aucun chercheur ne pense atteindre une vérité incontestable. La recherche est faite pour en faire naitre une autre.
Le corps ne peut être réduit à une machinerie fonctionnant avec une seule et même logique observable et soumise au régiment des statistiques. La naissance même de cette réflexion pluridisciplinaire en est une preuve. Mais dans un monde où il faut utiliser l’argument de l’ADN pour enseigner que le racisme n’a pas lieu d’être à quoi nous attendons-nous d’autre ?
Un corps sans âme est tout simplement un corps mort. Et psychologue je me dis, en écrivant ces lignes, qu’il est regrettable que dans des professions du psychisme ou du social il soit possible de penser la souffrance ou l’angoisse uniquement comme quelque chose de quantifiable et de mesurable, d’aller au-delà des mots avec une référence de cotation qui permet d’aller droit au but et au problème – et surtout de passer à côté de la souffrance qui amène nos patients. En témoigne le nombre de parents qui me présentent leur enfant en termes de HPI ou HPE, et qui me regarde comme si, en ayant prononcé ces trois lettres j’allais reconnaître qui était leur enfant.
Je invite donc à lire ce travail bien renseigné, sincère et intelligent. Cette rencontre des travaux de chercheurs nous instruit de leurs propositions d’études pour d’améliorer les conditions de travail pour les uns et les conditions de soins pour les autres. Et aussi, pour le plaisir de la discussion.