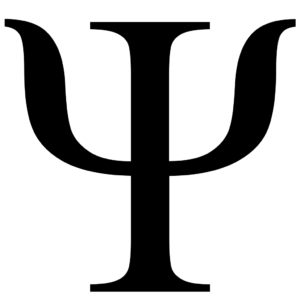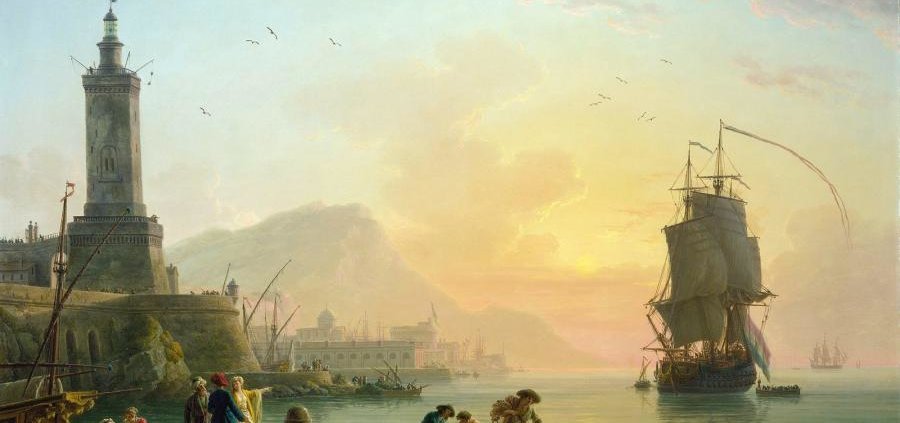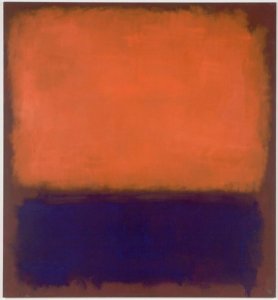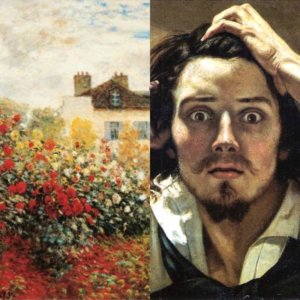PSYCHOTHERAPIE
Pour Qui?
« Il n’y a pas de vérité qui, à un certain moment, ne soit pas déjà passée par le cœur. » — Jacques Lacan
« Ce qui fait mal a souvent commencé par protéger ; la psychanalyse aide à reconnaître ce passé pour qu’il cesse de commander le présent. »
La psychanalyse s’adresse à celles et ceux que quelque chose, dans leur vie psychique, vient freiner, entraver, ou plonger dans une répétition dont ils ne voient pas l’issue. Ce peut être l’angoisse, la dépression, un burn-out, une obsession, une phobie, ou encore cette situation qui, malgré tous les efforts, se reproduit comme si elle obéissait à une logique inconnue.
Avant toute chose, faire une psychanalyse est une démarche personnelle. C’est un choix que l’on souhaite se donner. Il ne s’agit pas de changer ni de devenir un autre, mais de changer son positionnement et son rapport face à la chose, en tant que cela fait souffrir. Trouver une manière singulière de savoir y faire avec soi-même. C’est se construire un savoir y faire avec soi et dans lequel on se sentira en paix. C’est le choix de se donner le temps et l’espace d’une parole qui ne soit pas dictée par l’urgence de « s’en sortir ».
Car le patient n’est pas démuni : il porte un savoir — un savoir inconscient — devenu méconnaissable. Ce savoir se manifeste dans les répétitions, dans ces affects inscrits jadis comme une protection et qui, aujourd’hui, agissent comme une entrave.
On se demande : « Pourquoi ? Moi qui veux être heureux, qui fais tout pour l’être ? » Or, vouloir ne suffit pas : le désir ne se confond pas avec la volonté, car il est conduit par l’inconscient — et l’inconscient ne se maîtrise pas.
Les résistances ne sont pas de simples obstacles : elles sont le langage même de l’inconscient, et c’est en les rencontrant que l’on peut commencer à entendre ce qu’elles disent.
La psychanalyse invite à déplacer le regard : plutôt que de réduire sa souffrance à une histoire douloureuse, il s’agit d’y reconnaître la marque d’un « je » singulier, en prise avec son histoire mais aussi avec les inventions par lesquelles il a tenté de vivre avec.
Dans l’espace de la séance, il devient possible d’interpréter ses pensées, ses rêves, ses désirs, ses angoisses ; de leur donner la parole et de s’en faire, peu à peu, le traducteur.
Ainsi, se dégage la liberté de redevenir l’interprète de sa propre vie.
« Se découvrir sujet, c’est accueillir en soi l’inconnu que l’on porte depuis toujours. »
Quel « psy » choisir?
« Ce n’est pas la technique qui soigne, c’est la rencontre qui transforme. »
Beaucoup de patients se demandent quelle est la différence entre un psychologue, un psychiatre et un psychanalyste. Ces appellations désignent des formations et des fonctions distinctes, mais ce qui marquera le plus la différence, dans la pratique, c’est l’orientation théorique adoptée par le praticien.
Cette orientation — qu’elle soit cognitive-comportementale, psychanalytique, systémique ou autre — influence la manière dont vous serez écouté, accompagné, diagnostiqué et orienté. Elle détermine la place accordée à votre parole, au symptôme, et à la construction de votre histoire.
Avant d’entamer une psychanalyse, il est donc essentiel de se renseigner sur ces différentes approches pour choisir celle qui résonne le plus avec votre démarche.
Le psychiatre
Médecin de formation, il a d’abord étudié la médecine générale avant de se spécialiser en psychiatrie. Il peut prescrire des médicaments et dispose d’une connaissance approfondie de la biologie humaine et des effets pharmacologiques. Son rôle peut être d’articuler traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique.
Le psychologue
Il a suivi cinq années d’études universitaires (Master 2) et réalisé au moins 750 heures de stage en institution (hôpitaux de jour, services psychiatriques, CMP, associations…). Contrairement au psychiatre, il n’a pas de compétence médicale et ne peut pas prescrire de médicaments, même s’il connaît leurs effets et indications.
Et le psychanalyste ?
Le psychanalyste est un praticien — psychologue, psychiatre ou d’une autre formation initiale — qui a choisi de se former à la psychanalyse et de la pratiquer. Sa formation repose sur trois piliers :
- Sa propre analyse personnelle (indispensable pour accueillir la parole de l’autre sans l’écraser de la sienne) ;
- La supervision régulière de sa pratique ;
- Un travail théorique continu (lectures, séminaires, échanges entre praticiens).
Un psychologue ou un psychiatre peut donc être psychanalyste, mais tous ne le sont pas. Ce qui distingue le psychanalyste, c’est de travailler avant tout à partir de l’inconscient et du transfert, en laissant place à ce que la parole fait surgir au-delà de ce que l’on croit vouloir dire.
Psychanalyse?
Être dans le désir de sa parole
« Ce que l’on ne veut pas savoir de soi-même, c’est pourtant ce qui commande nos pas. »
Faire une psychanalyse, c’est s’accorder un temps pour regarder autrement son histoire, pour éclairer ces zones d’ombre qui continuent d’agir à notre insu dans nos relations — en famille, en couple, entre amis, au travail. C’est offrir à ses questions d’existence un espace où elles peuvent se dire et se transformer.
On croit souvent se remettre en question seul, mais nos propres limites nous ramènent vers les mêmes impasses. L’analyse est un travail patient qui met à jour les effets de l’histoire singulière sur la vie actuelle, non pour effacer le passé, mais pour desserrer l’étau qu’il exerce. Il ne s’agit pas de supprimer l’intensité de la vie, mais d’en devenir l’auteur.
Dans une psychanalyse, la relation est celle d’un sujet à un autre. L’analyste n’est pas là pour parler à la place du patient, ni pour se taire en retrait, mais pour accueillir et travailler ce qui se dit — et aussi ce qui se tait. L’analyse offre à l’intime la possibilité de se dire dans sa vérité, hors du regard normatif du social.
D’où ça vient ? Et comment ça parle ?
Ce « ça » est l’inconscient, que Freud appelait « l’autre scène ». Il se manifeste dans les rêves, les lapsus, les actes manqués, mais aussi dans les symptômes qui se répètent. Faire une analyse, c’est se donner la parole et lui accorder de la valeur — une valeur hors de l’efficacité immédiate, mais tournée vers la transformation durable.
On attend parfois du psychanalyste un savoir prêt à l’emploi. Mais le seul savoir qu’il revendique est celui de soutenir l’écoute, de mettre en lumière l’affect en jeu, comme une lampe torche qui éclaire sur ce qui tremble et ce qui insiste. Le chemin, ensuite, appartient au patient se
La position de l’analyste
L’analyste travaille avec le langage, non comme un simple outil, mais comme ce qui engage le corps, l’affect, l’inattendu. Les mots ne sont pas que des mots : ils peuvent faire trembler, surprendre, émerveiller. Sa position implique de renoncer à plaquer ses propres vérités ou théories, pour rester au plus près de ce qui se dit là, dans cette rencontre.
Dans un monde qui exige d’aller vite, la psychanalyse invite à reprendre le temps. C’est votre rythme qui compte, celui qui permet au travail de se faire sans violence et sans précipitation, afin que la parole devienne l’alliée d’un déplacement véritable.
« Prendre le temps, c’est déjà commencer à se libérer de ce qui nous presse.
Qui suis-je?
« On ne devient pas psychanalyste par diplôme, mais par travail sur soi, rencontre des autres, et engagement dans la parole. »
D’orientation psychanalytique, je me suis formée en Master de recherche à la psychopathologie et à la recherche interdisciplinaire à l’Université Paris 7 – Denis Diderot, après une licence à l’Université Paris Nanterre. Mon parcours a été jalonné de stages variés : Centre Médico-Psychologique, hôpital de jour, CATTP, auprès d’adultes, d’adolescents et d’enfants, dans des contextes cliniques divers.
Depuis 2019, j’exerce en libéral, accueillant adultes et adolescents dans un cadre analytique. En parallèle, je participe au travail clinique et institutionnel de l’hôpital de jour de Ville-d’Avray, notamment dans les séances de psychodrame psychanalytique.
Un engagement dans la formation continue
Ma pratique se nourrit d’un travail théorique constant. Je participe à des séminaires et à des groupes de recherche au sein d’associations psychanalytiques, où j’ai également proposé et animé un groupe de travail sur l’identification dans le transfert. J’écris pour la revue Psychologie Clinique où contribue à des lectures et commentaires d’ouvrages pour des publications spécialisées.
Une orientation psychanalytique assumée
Mon approche est nourrie par l’enseignement des grandes figures de la psychanalyse, de Freud et Lacan à Maud Mannoni et Françoise Dolto, ainsi que par des travaux contemporains qui articulent la pratique clinique et la recherche théorique.
Je conçois la cure comme un lieu où le patient peut devenir l’interprète de sa propre histoire, dans un espace où la singularité prime sur le modèle, et où la parole est le principal outil de trava
Un travail de recherche
« La psychanalyse est la seule discipline où l’on commence par ce qu’on ne sait pas. »
Ma recherche en psychopathologie part d’une interrogation : Qu’est-ce qui, dès l’origine, oriente la structure du sujet et conditionne son rapport au désir, à la jouissance et à l’Autre ?
Le jugement s’est imposé comme point de départ. Avant toute décision consciente, il marque une césure dans l’expérience : distinguer, reconnaître, rejeter. Freud, dans Die Verneinung (1925), différencie le jugement d’existence et le jugement d’attribution, éclairant la façon dont le sujet, dès l’aube de sa vie psychique, articule reconnaissance et symbolisation.
Ce jugement est inséparable du rythme dans lequel il s’inscrit. Le rythme, battement des échanges premiers avec l’Autre, fonde le temps et l’espace où naissent les représentations et les affects. Comme l’ont montré Dolto et Mannoni, ce rythme inaugural soutient ou entrave la capacité d’un sujet à se situer et à élaborer ses expériences.
C’est dans cette trame que surgit la question de la jouissance. Elle met à l’épreuve les limites intrapsychiques : limites qui s’édifient dans l’enfance à travers l’interdit, mais qui se modifient tout au long de la vie. Lacan a souligné la tension constante entre jouissance et loi, là où le réel vient éprouver la structure et parfois la désorganiser.
De là se dégage la question de l’identification, au sens lacanien : non pas identité sociale ou consciente, mais marque primitive, trait unaire issu de la rencontre entre jugement, rythme et jouissance. Cette inscription originaire fixe un repère qui oriente la position du sujet dans le langage, ses choix d’objets, ses attachements et ses refus.
Ainsi, jugement, rythme, jouissance et identification ne sont pas pour moi des concepts isolés, mais les coordonnées d’un même mouvement, où se joue la singularité du sujet dans son rapport au langage, au corps et aux autres.