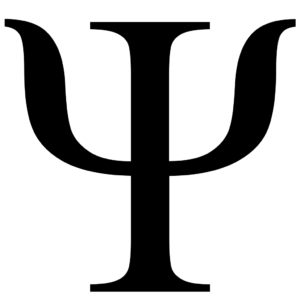Menaces sur les liens, du bébé à l’adolescent
Alain Braconnier et Bernard Golse,Paris, éditions ères, 2023
Voici un ouvrage où des psychanalystes s’attachent à penser les liens, à partir de leur propre expérience clinique.
En psychanalyse, parler du lien, c’est aussi parler de ce qui fait souffrance, de ce qui amène à consulter. Un lien menacé se manifeste comme un affect bouleversant, intense, prenant parfois la forme d’un symptôme. Les auteurs présentent des vignettes cliniques qui ont marqué leur pratique, parfois après plusieurs années de travail. Et soudain, l’inconscient de l’autre se donne à voir dans sa forme la plus permise, comme un instantané précieux. Ce moment est possible parce que le patient, à son tour, reconnaît la part de vérité contenue dans son dire.
Rien n’est donné d’emblée : il faut du temps. Chaque chapitre s’ouvre sur les interrogations de l’analyste lors de la première rencontre : comment accueillir la demande, saisir la structure, cerner le malaise, repérer le symptôme ? Les liens à l’autre sont ces trésors enfouis, qui font tantôt désirer, tantôt angoisser. À quoi tiennent-ils ? Que supportent-ils ? La rencontre avec l’analysant confronte l’analyste à « une colle » : de quoi est fait ce lien ? Que veut dire ce symptôme ? Quelle demande s’adresse à moi ?
Les auteurs livrent ainsi de beaux témoignages d’analystes, souvenirs d’expériences marquantes où le transfert joue un rôle décisif : c’est souvent là que se dévoilent l’origine, la couleur et la matière du lien.
La thérapie s’ouvre toujours sur un certain flou, partagé par le patient et l’analyste. Le lien se présente à couvert : visible, mais encore inavoué, trop écorché pour être formulé. Puis, un jour, l’écoute s’éclaire d’une parole qui met le lien en évidence. L’affect est douloureux : ce lien est menacé. Souvent, c’est cette menace qui conduit à consulter, quand la souffrance quotidienne et la répétition finissent par donner le sentiment d’un échec.
Ces récits montrent que le lien, qu’il soit social, familial ou amical, peut se vivre comme un contenant, un support pour l’affect. Solide, épais, actuel, il résiste aux secousses ; mais la menace qui pèse sur lui a l’effet d’une catastrophe, et devient une raison d’être du symptôme.
Le titre évoque aussi la menace comme une matière vivante, parasite qui vient se poser sur le lien et le bouleverser. Dans son article, Sylvain Missonnier rappelle que le lien existe avant même que la menace ne s’y abatte : qu’elle prenne la forme d’un deuil, d’une rencontre amoureuse, de l’adolescence, ou encore d’un événement collectif comme la pandémie, la guerre ou le bouleversement climatique, tout ce qui fait catastrophe dans la subjectivité devient menace pour le lien.
Quel que soit l’âge ou l’expérience de l’analyste, c’est avec cette écoute à la fois ignorante et savante que se déchiffrent les rébus du sujet, dans le temps nécessaire pour que l’analyse se déploie. Et vient ce moment où l’analyste restitue ce qu’il a entendu : l’interprétation. Moment précis, possible seulement si le patient peut la recevoir, où quelque chose se dénoue — parfois par un mot, une phrase, un lapsus, un éternuement. Alors, la lumière se fait sur une vérité qui trouve enfin sa formulation.
C’est toujours de la bouche de l’analysant que la vérité sort. La bouche est l’un des premiers instruments du lien : par elle, on se nourrit, on éprouve pour la première fois l’alternance des tensions et de leur apaisement, et, plus tard, on parle. Tant que la chose n’est pas dite, l’analyste n’a qu’une impression diffuse de ce qui résiste à se dire : comme si un flou lui était transmis avec le récit. Pour approcher ce qui se rejoue dans le transfert, il faut rester au bord du discours, sans s’y engloutir. Car le transfert est un semblant de lien : on vient parler non pas à l’analyste en tant que personne, mais à ce semblant de sujet que vide la parole.
Ainsi, le lien supporte, tremble sous la menace, mais persiste. Les auteurs ne parlent pas d’un lien que l’on pourrait rompre : il s’agit de ceux qui comptent. Dans chacun de ces récits, le lien est à la fois menacé et vital — et c’est à la menace, non au lien, qu’il appartient de se rompre au moment juste.