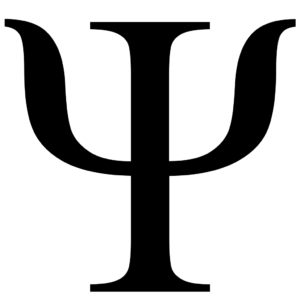Renaissance
Nos petits, petits autres qui vivent avec ou autour de nous, sont une grande énigme. Ils rappellent à notre propre mystère et à cette ignorance que nous avons acquise au fil des années, de nous-même et d’où nous venons. Une part de nous se soulève en leur présence : d’abord un « tu » qui nous fut adressé puis un « je » adressé à l’autre, sont réinterrogés. Nos premiers affects, tels qu’ils se sont manifestés les toutes premières fois de notre existence, se révèlent à mesure que nos progénitures grandissent.
Les nourrissons, les bébés, les enfants et les adolescents sont peut-être le seul accès réel ou le moyen le plus objectif d’avoir sur nous un œil, une porte entrouverte sur ce que nous étions quand nous sommes nés. Sur ce que nous sommes, en tant que vectorisés d’un objet « a » invariant.
Quant aux adultes qui nous ont pouponnés, nous en apprenons un peu sur eux aussi en compagnie des enfants. Comment cela ? Parce que le langage des nourrissons n’est pas fait de mots mais d’appels, de cris, de soupirs…, cela nous touche au plus profond de notre être. C’est le langage premier, celui dont nous avons nous-mêmes usé et dont nous avons reçu des réponses (l’absence de réaction étant une réponse). C’est bien par l’absence des mots qu’on est en présence de l’affect premier.
Petit à petit, ils apprennent à communiquer avec nous, à dire, avec des codes que nous sommes capables de reconnaître. Mais au départ, c’est aussi flou qu’un sentiment devant une peinture qui nous émeut : à la fois plein d’affects et sans mot. C’est fort parce que ce n’est pas parlé.
C’est une catastrophe, un renversement dans le réel des parents ou de l’éducateur faisant face à un bébé ou à un enfant. La distinction se fait entre nourrisson, bébé, enfant et adolescent. Non pas pour cliver l’individu en stades, mais parce que les outils du dire changent de forme avec les années. Ainsi, ils éveillent chez l’adulte de plus en plus clairement “la chose”.
Que ce soit pour jouir d’eux-mêmes ou se maintenir en vie, l’adulte est nécessaire à l’enfant. C’est une responsabilité quotidienne, sérieuse et vitale. Mais il ne va pas de soi qu’un adulte sache prendre soin d’un tout petit : ce n’est pas inné, ni une donnée biologique ou génétique propre à l’homme que d’entendre l’autre qui ne parle pas (encore) notre langue.
Françoise Dolto l’a écrit :
« Il faut une très grande maturité pour être capable d’être parent, car cela implique d’être conscient que ce n’est pas une situation de pouvoir, mais une situation de devoir, et qu’on n’a aucun droit à attendre en échange. »
La rencontre avec un petit d’homme est un renversement, car elle pousse l’adulte au lieu de ses identifications les plus anciennes. Une identification, comme le traite Octave Mannoni dans La désidentification, se révèle face à cet être nouveau et singulier.
Autrement dit, la réponse de l’adulte se compose toujours de l’écho des réponses qu’il a reçues de ses propres figures d’attachement, ainsi que de l’affect éprouvé en retour.
Comme psychanalyste, je reçois des parents qui ne se reconnaissent pas dans leur propre parole adressée à leur enfant, ou des adultes qui, dans leur couple, disent « refuser d’être traités comme un chiffon » et dont on apprend que la mère fut femme de ménage. Ces adultes sentent que la colère éprouvée face à l’enfant les bouleverse, mais elle est bien là. Vient alors le temps de la désidentification.
La détresse du parent est à prendre au sérieux si l’on veut prendre soin des enfants. Tous les parents n’ont pas conscience d’être en détresse. Si la colère qu’ils ressentent n’est pas proportionnelle à l’évènement qui l’a provoquée, ils invoquent la fatigue ou disent que « l’enfant sait très bien » … Mais non : l’enfant ne le sait pas, il reçoit et ça le fait souffrir.
Les enfants sont une énigme pour l’adulte, tout en étant les sujets humains les plus ouverts et lisibles. Les plus jeunes n’ont pas encore transformé ce qu’ils ont sur le cœur à coup d’idéaux du Moi et de censure. Ils donnent volontiers accès à leur intimité, tandis que notre appareil psychique d’adulte est parfois trop vieux ou trop aliéné pour en saisir ce qui est exprimé.
Avant l’apparition de la psychanalyse, on diagnostiquait volontiers une “débilité”. De Freud à Lacan, en passant par Anna Freud, Mélanie Klein, Winnicott, Dolto et Maud Mannoni, nous avons appris à rencontrer les petits d’hommes comme des êtres faits de la même matière affective que nous, adulte. Pourtant, les mœurs ont encore besoin d’être nourries car il n’est pas rare d’entendre dans notre société : « Avant trois mois, il n’y a pas grand-chose à partager avec un nourrisson, ça dort, ça mange, ça chie ». Pas si rares, ces paroles ne révoltent même pas grand monde dans notre cité parisienne. J’en ai été témoin et pas de façon exceptionnelle.
Dans notre société, le jeune enfant est souvent réduit à un objet de stimulation et de mesure (HPE, HPI…), alors que se développer, c’est d’abord dans son âme et dans son cœur, auprès d’adultes qui permettent — ou non — certains gestes, certaines pensées.
Il est nécessaire de parler de l’enfant en tant qu’humain, avec ses outils et sa dépendance à ses figures aimées. Toutes les règles du bon développement intellectuel ne valent pas une oreille et un regard avertis.
Aller à la rencontre de soi à travers ce que l’on ressent face à son enfant s’adresse à tous. Les enfants sont des désirants, des chercheurs, dont la soif de savoir sera accueilli ou non par les parents.
Ne culpabilisons pas : nous faisons tous avec ce qui nous a ravis, blessés, manqués ou comblés. Mais se positionner face à un autre et prendre la mesure de sa soif singulière de savoir permet un véritable bien-être familial et personnel.
Les enfants nous apprennent beaucoup de leur regard sur le monde, sur ces petites choses que nous avons cessé de questionner. Ils offrent une seconde chance, une renaissance, à côté d’eux.
La question n’est donc pas : « est-ce bien ou mal ? », mais : « qu’est-ce que ça fait d’être pour la première fois face au monde ? »
Même accompagné de la meilleure notice éducative, c’est l’affect qui vibre dans le cœur du parent qui détermine la nature de la parole. L’enfant perçoit l’affect à vif, même sans en connaître la cause, et devra composer avec cet affect sans mot.
Ni le nourrisson ni l’enfant ne sont passifs face à la parole de l’adulte, quelle qu’elle soit.