Maltraitance de l’enfant
Selon l’OMS, la maltraitance infantile regroupe « toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir ».
Un jour, une jeune femme arrive chez son grand frère et dit : « Papa a abusé de nous. » Une bombe vient d’exploser au cœur d’une famille.
Souvent révélées des années plus tard, les maltraitances marquent la peau, le cœur et l’âme d’une façon indélébile. Ces derniers temps, l’actualité médiatique donne davantage la parole aux victimes, et un mot revient sans cesse : silence.

La loi du silence
Ce silence, il faut le penser. On dit parfois qu’il s’impose pour protéger la famille de la honte. Mais tous les patients que j’ai entendus m’ont confié avoir déjà « plus ou moins » parlé. Et ce « plus ou moins » demande à être déplié. Dire le moins pour laisser entendre le plus ? Ou dire le plus tout en dissimulant l’essentiel ?
Ceux qui ont laissé échapper quelques mots ne savent pas s’ils n’en ont pas déjà trop dit. Et si ce qu’ils ont confié, même à demi, suffisait déjà à blesser l’auditoire ? Dans cette crainte, la personne maltraitée peut se vivre comme un bourreau à son tour, celui qui vient inscrire une cicatrice à jamais ouverte dans le corps familial.
Il est plus supportable de penser que les proches n’ont pas compris, plutôt que de se confronter à l’idée qu’ils ont compris… et n’ont rien fait. C’est ainsi que beaucoup se résolvent au mutisme, et à une solitude qui se cristallise.
Paroles inentendables
Quand une révélation échoue, ce n’est pas toujours par indifférence. Certaines paroles sont inentendables, et non pas seulement inaudibles. Trop graves, trop destructrices, elles menacent aussi l’intégrité psychique de celui qui les reçoit. Le refoulement peut être immédiat : non-reconnaissance, esquive, effacement.
Et parfois, l’inverse : l’auditeur entend, et tout s’effondre. Les idéaux familiaux se brisent, les liens affectifs vacillent, les repères psychiques se défont. Alors commence la bataille : juridique, institutionnelle, intime. L’affaire quitte le secret, mais la plaie reste béante.
Le temps de reconnaissance est long. Les victimes mettent parfois vingt ans à trouver les mots. Et lorsque la justice se ferme — prescription oblige — il ne reste que d’autres oreilles… pas toujours prêtes à supporter le poids de ces mots.
Pardonner ou pas : ce n’est pas la question
La question du pardon revient souvent. Mais elle est, pour beaucoup, un faux centre. Ce n’est pas de pardonner ou non qu’il s’agît, mais de fabriquer un savoir-faire avec l’événement traumatisant.
Le pardon n’a rien à faire ici : il ne constitue pas l’axe de la reconstruction. Ce qui compte, c’est de trouver comment vivre avec ce qu’il reste après avoir été maltraité, d’accepter que cet événement aura toujours une place, douloureuse, mais avec laquelle il sera possible de composer.
Il ne s’agit pas de « libérer » le bourreau pour se libérer soi-même, mais de se libérer soi-même en donnant une forme à ce qui s’est produit. Paradoxalement, nombre de victimes se sentent redevables, comme si elles devaient se faire pardonner… d’avoir été maltraitées. Ce paradoxe nourrit une colère qui agit comme un fardeau et qu’elles voudraient voir disparaître. Pourtant, cette colère, comme tout symptôme, dit quelque chose : elle est une tentative de mise en sens de l’insupportable.
Et du côté du maltraitant ?
Il n’y a pas toujours conscience de la gravité de l’acte. Certains lèvent la main sur leur enfant sans remords, persuadés que « c’est pour son bien », « Sinon il ne comprend pas ». Cela peut relever de la bêtise, de l’inculture, ou d’une pathologie.
Du côté du maltraitant comme de la victime, vouloir « se pardonner » revient souvent à tenter d’effacer l’événement — ce qui est impossible. On ne sort jamais indemne de ce que l’on a fait subir, pas plus que de ce que l’on a subi.
Qui juge ?
Qu’il s’agisse d’une gifle, d’humiliations, de coups ou d’inceste, c’est à celui qui reçoit la violence de dire le mal qui lui a été fait. L’adulte en devenir devra vivre avec ces souvenirs, et avec le peu d’oreilles qui sauront écouter sans détourner le regard.
La vraie question, au fond, n’est pas seulement celle de la justice, ni même du pardon : c’est celle de l’adresse. Qui entend, et que fait-on de ce que l’on entend ?

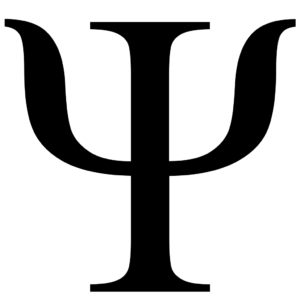

 SST
SST