La parole et le langage sont-ils indissociables?
Plus que des concepts, la parole et le langage sont, pour la psychanalyse, de véritables outils. Le Larousse définit le langage comme la « capacité […] d’exprimer sa pensée et de communiquer » et la parole comme la « faculté de s’exprimer par le langage articulé ». La parole est un support possible du langage, tout comme l’écriture, la musique, la peinture, la langue des signes, les rêves…
L’enfant sauvage de l’Aveyron
En 1828, Jean Marc Itard tente d’apprendre la parole à un enfant sauvage trouvé dans l’Aveyron. L’éducation purement cognitive et par imitation échoue, révélant que la langue porte autre chose que du vocabulaire et de la syntaxe.
La communication repose sur autre chose
Chaque culture repose sur un socle de symboles, d’émotions et d’interdits. Les troubles de la communication, comme dans l’autisme, ne se résolvent pas par un simple dressage comportemental. Il faut entrer dans la “langue maternelle” du sujet (au sens lacanien) : un rapport intime au langage, structuré par le désir et l’histoire singulière.
Sujet autistique : faire advenir un « je »
L’enjeu est de créer les conditions pour qu’un “je” advienne. La psychanalyse apporte la subjectivation : reconnaître l’autre sans menace, se reconnaître soi-même comme sujet distinct. Cela passe par l’intersubjectivité, le jeu, la mise en mots des affects et des angoisses archaïques. Certaines stéréotypies peuvent être signifiantes, elles sont des passerelles vers l’échange.
Au-delà du cognitif
La parole mobilise l’imaginaire, le symbolique et la pulsion. Exemple : le bégaiement peut traduire un conflit dans le rapport au père, montrant que la rééducation doit s’articuler à un travail sur la pulsion. Le langage engage bien plus que la cognition.
Savoir parler une langue, c’est en connaître les symboles et les tabous.
La communication repose sur autre « Chose »
Autrement dit, on parlerait de débilité pour signifier ce que nous ne comprenons pas chez l’autre – ce qui fait le réel du sujet. S’il est difficile de changer de langue, ou d’en apprendre une autre c’est bien que la communication repose sur autre « Chose » d’un peuple à un autre. Par autre « Chose », je veux dire un autre « socle » porteur d’émotions, de symboles et d’interdits. Des points de capteurs différents.
De la même manière, si on pousse ce raisonnement il convient de comprendre qu’un handicap de communication et d’interaction avec l’autre, comme c’est le cas chez l’autiste, ne peut se résoudre par le dressage comportemental. Autrement dit, cela n’a rien à voir. Ainsi, plutôt que de forcer l’éducation à notre norme sociale et/ou personnelle il convient mieux de s’intéresser à la « langue maternelle » (au sens lacanien des termes) de quelqu’un pour le comprendre et donc ouvrir une possibilité de communication.
Loin de moi la prétention d’ouvrir sur la proposition concrète d’une autre méthode à l’efficacité indiscutable. Là où je veux en venir c’est que le langage et la parole qui le porte, ont une toute autre dimension. Une dimension supplémentaire à ce qui est de l’ordre du cognitif, et essentielle à utiliser. On peut donc être sur-diplômé et avoir des difficultés d’apprentissage d’une langue étrangère ou même à s’intégrer dans une entreprise.
A l’inverse, on peut manquer d’éducation mais être polyglotte et socialement habile. Pour conclure, je dirais que la part de symbolique et d’imaginaire que porte la langue est toute aussi importante que le bon fonctionnement de la machine corps, organique et cognitive pour en avoir l’usage. Et cela n’est pas accessible de la même manière à tous.
Comme Olivier Douville le dit « savoir parler une langue c’est en connaître les symboles et les tabous ».
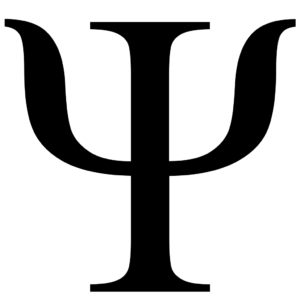

 Raphaël
Raphaël